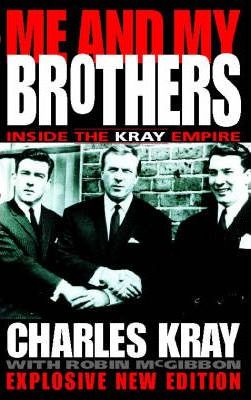L'Espagne, centre de production de cocaïne
Armada de Colombia | Août 2025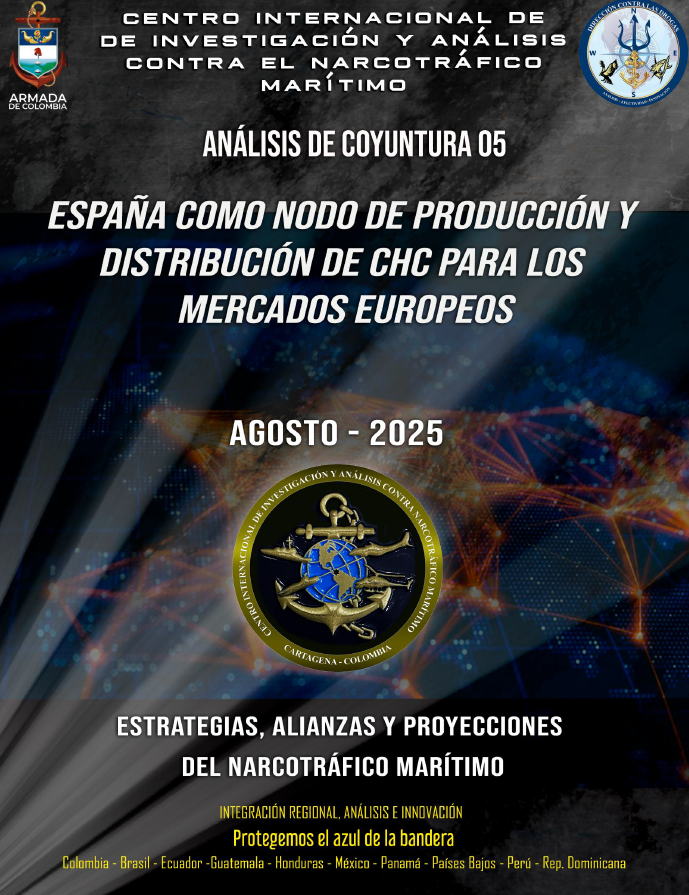 La Marine colombienne, via le Centre International d’Enquête et d’Analyse contre le Narcotrafic Maritime, a publié une étude sur le rôle de l’Espagne comme centre (secondaire) de production de cocaïne.
La Marine colombienne, via le Centre International d’Enquête et d’Analyse contre le Narcotrafic Maritime, a publié une étude sur le rôle de l’Espagne comme centre (secondaire) de production de cocaïne.
La place de l’Espagne a évolué entre 2023 et 2025, passant du rôle de simple zone de transit pour la cocaïne destinée à l’Europe à celui de producteur. Ce changement s’explique par la saturation du marché européen, la volonté de réduire les risques liés à la traversée transatlantique et la consolidation d’alliances entre réseaux criminels internationaux. Les pays andins continuent de produire des quantités record de pâte-base, mais une part croissante de cette production est envoyée semi‑transformée pour être raffinée sur le territoire espagnol. Les régions les plus concernées sont la Galice, Valence, l’Andalousie et le Pays basque, où les autorités ont découvert des laboratoires clandestins capables de raffiner entre 100 et 250 kilos de cocaïne par semaine. Des opérations policières telles que « Costa Segura » à Cadix en 2023 ou « Mar Blanco » à Valence en 2025 illustrent cette réalité, l’État espagnol constatant une hausse de 45 % des détections de laboratoires sur la période.
Cette transformation s’appuie sur la situation géographique de l’Espagne, à la croisée de l’Atlantique et de la Méditerranée, qui facilite l’acheminement des produits chimiques et des cargaisons semi‑élaborées. Les ports de Valence, Algésiras ou Bilbao traitent des volumes énormes de marchandises, et moins de 5% des conteneurs sont inspectés physiquement. Cette faible capacité de contrôle, combinée au savoir‑faire des organisations criminelles locales et à la possibilité de dissimuler des produits sous des couvertures commerciales légales, permet l’entrée de la pâte de coca pour raffinage. Les modes de transport se diversifient : au transport maritime s’ajoutent des vedettes rapides en provenance du Maroc ou du Portugal, des avions privés venus d’Afrique de l’Ouest et des liaisons terrestres reliant des ports secondaires au reste de l’Europe, ce qui crée un réseau logistique flexible résistant aux pressions policières.
Plusieurs facteurs expliquent cette montée en puissance. Sur le plan économique, transformer la pâte de cocaïne sur le sol espagnol réduit les pertes en cas d’interception et augmente les marges, car la cocaïne raffinée se vend en Europe entre 25.000 et 35.000 euros le kilo contre 7.500 à 10.500 euros pour la pâte. En 2023, les ports européens ont saisi 419 tonnes de cocaïne, soit près de 30 % de plus en un an ; l’Espagne en a intercepté à elle seule 118 tonnes, confirmant son rôle d’entrée principale vers les marchés à forte demande comme l’Allemagne, le Royaume‑Uni ou la France. Le prix de la cocaïne y est donc relativement bas, car les cargaisons arrivent plus directement, sans les surcoûts liés à un transit prolongé.
Sur le plan criminel, de nouveaux consortiums sont apparus, combinant l’expertise de chimistes colombiens, les capitaux des cartels mexicains de Sinaloa et du Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) et le contrôle territorial des réseaux albanais sur les ports européens. Entre 2023 et 2025, les forces de l’ordre ont démantelé vingt et un laboratoires clandestins (neuf en Galice, six dans la Communauté valencienne, quatre en Andalousie et deux au Pays basque), saisissant 8,7 tonnes de cocaïne raffinée et 6,2 tonnes de précurseurs. Des cas d’étude comme le laboratoire de Pontevedra (Galice, 2023) capable de produire 200 kilos par jour et les opérations menées à Valladolid, Bilbao, Málaga ou dans la région de Valence montrent l’ampleur industrielle de certaines installations.
D’autres éléments jouent un rôle important. Les ports saturés permettent aux trafiquants d’importer des précurseurs chimiques tels que le permanganate de potassium, l’acétone ou l’acide sulfurique en les déclarant comme produits industriels ou agricoles. Les saisies records à Algésiras et Valence (treize tonnes en novembre 2024 dans un chargement de bananes ; neuf tonnes et demie lors de l’opération « Nano » 2023 ; 8,4 tonnes en 2022) montrent le volume colossal du trafic et la difficulté de tout contrôler. Les laboratoires clandestins utilisent des équipements sophistiqués (réacteurs industriels, presses hydrauliques, systèmes de ventilation) manipulés par des chimistes colombiens. Ils atteignent des taux de pureté supérieurs à 85 % et sont implantés dans des zones industrielles ou rurales camouflées, ce qui rend leur détection complexe et leur modèle facilement reproductible.
Enfin, des lacunes réglementaires et des incohérences institutionnelles contribuent au phénomène. L’Union Européenne classe certains précurseurs comme le permanganate de potassium comme sensibles, mais pas l’acétone pourtant essentielle au raffinage, réduisant ainsi la traçabilité des produits. La feuille de route européenne contre le narcotrafic préconise l’installation de scanners et la création d’alliances portuaires, mais l’application demeure inégale selon les pays et aucun système de contrôle logistique en temps réel n’a encore été unifié. Ces insuffisances renforcent la position de l’Espagne comme centre de raffinage et de distribution.
À court terme, les laboratoires clandestins devraient se multiplier et se déplacer vers des zones rurales moins surveillées. Les organisations criminelles utiliseront davantage de sociétés écran pour importer équipements et produits, consolidant leur réseau logistique. À moyen terme, l’Espagne pourrait devenir un véritable hub logistique et productif de cocaïne pour l’Europe occidentale, combinant production locale et redistribution vers le centre et l’est du continent. Les alliances entre cartels latino‑américains, réseaux albanais et groupes espagnols se renforceraient, et la spécialisation des laboratoires permettrait de produire jusqu’à 250 kilos par semaine. Toutefois, une intensification des contrôles douaniers pourrait pousser ces activités vers des États à la capacité de contrôle plus faible, et les organisations pourraient diversifier leurs produits en mélangeant la cocaïne avec des drogues synthétiques.
En conclusion, l’Espagne est devenue un maillon central de la production et de la distribution de cocaïne en Europe. La conjonction de facteurs économiques, criminels, logistiques, techniques et institutionnels crée un environnement favorable à ce basculement. Sans un renforcement rapide des contrôles et une coopération internationale plus efficace, le nombre et la capacité des laboratoires clandestins risquent de continuer à croître, consolidant davantage encore le rôle de l’Espagne dans l’économie du narcotrafic ou, en cas de pression accrue, poussant la production vers d’autres pays européens.
Voir l’étude ici
ou https://cimcon.armada.mil.co/sites/default/files/sites/default/files/descargas/pdf/ADC%2005%20CMCON%202025%20-%20ESPA%C3%91A%20COMO%20NODO%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%20Y%20DISTRIBUCI%C3%93N%20DE%20CHC%20PARA%20LOS%20MERCADOS%20EUROPEOS.pdf
| Désolé, cette page est seulement accessible aux abonnés de crimorg.com! |
|---|