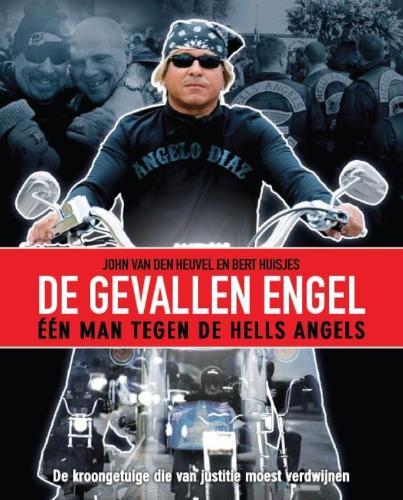Crime organisé et terrorisme : les dangers d'une lutte déséquilibrée
Université Paris-Nanterre - France | Octobre 2025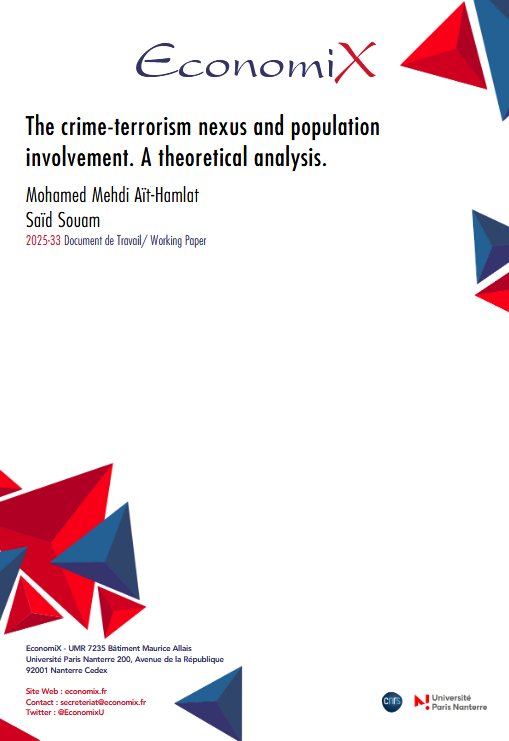 Deux économistes de l’Université Paris Nanterre, Mohamed Mehdi Aït-Hamlat et Saïd Souam (EconomiX, CNRS), publient une analyse théorique originale sur les interactions stratégiques entre criminalité organisée et terrorisme. Leur modèle de théorie des jeux, qui met en scène trois acteurs (un gouvernement, un groupe terroriste et une population civile), apporte un éclairage nouveau sur les dynamiques qui lient ces deux phénomènes et sur l’efficacité des politiques publiques.
Deux économistes de l’Université Paris Nanterre, Mohamed Mehdi Aït-Hamlat et Saïd Souam (EconomiX, CNRS), publient une analyse théorique originale sur les interactions stratégiques entre criminalité organisée et terrorisme. Leur modèle de théorie des jeux, qui met en scène trois acteurs (un gouvernement, un groupe terroriste et une population civile), apporte un éclairage nouveau sur les dynamiques qui lient ces deux phénomènes et sur l’efficacité des politiques publiques.
L’originalité de cette recherche réside dans l’intégration de la population comme acteur actif, et non comme simple victime passive. Les auteurs modélisent comment chaque protagoniste alloue stratégiquement ses ressources : le gouvernement entre lutte antiterroriste et lutte contre la criminalité ; le groupe terroriste entre activités terroristes et activités criminelles ; la population dans son soutien (ou non) à l’action gouvernementale.
Le modèle démontre que la population peut, sous certaines conditions, substituer partiellement les ressources étatiques dans la lutte antiterroriste. Ce soutien populaire devient effectif lorsque la perception de la menace terroriste est suffisamment élevée et que les efforts du gouvernement et du groupe terroriste sont relativement équilibrés. En revanche, si l’asymétrie est trop forte (le gouvernement très supérieur ou très inférieur au groupe terroriste), la population n’intervient pas, jugeant son effort soit inutile, soit insuffisant.
L’analyse confirme ce que la littérature empirique documente depuis longtemps : un groupe terroriste confronté à des opportunités criminelles lucratives peut réorienter ses efforts de la violence terroriste vers la criminalité. Cette réorientation dépend toutefois de l’allocation des ressources gouvernementales et de la perception de la menace par la population.
Les auteurs s’appuient sur une revue exhaustive de cas documentés : les FARC colombiennes et leur implication dans le trafic de cocaïne ; Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) dans le Sahel avec le trafic de drogue et les enlèvement ; les groupes d’Asie du Sud-Est (Hezbollah au Levant, LTTE au Sri Lanka, Abu Sayyaf aux Philippines).
Le modèle révèle un effet pervers : une attention gouvernementale accrue sur une seule menace peut paradoxalement renforcer l’autre. Lorsque le gouvernement néglige la lutte anti-criminalité, le groupe terroriste, déjà hégémonique sur ce front délaissé, peut réorienter ses ressources vers le terrorisme, créant un effet paradoxal : plus le gouvernement se concentre sur l’antiterrorisme, plus il peut stimuler l’activité terroriste.
Les analyses comparatives statiques montrent comment les variations de paramètres clés influencent les équilibres : augmentation des coûts du crime ou du terrorisme, évolution des attitudes publiques face à la violence, modifications des budgets gouvernementaux. Les auteurs soulignent que les politiques publiques doivent impérativement maintenir un équilibre entre lutte antiterroriste et lutte anti-criminalité pour éviter de créer des « angles morts » exploitables par les organisations.
Les chercheurs concluent que les approches fragmentées sont vouées à l’échec. Depuis 2001, les cadres internationaux de lutte contre le financement du terrorisme se sont multipliés (résolutions ONU 1373 et 1377, recommandations du GAFI), mais restent souvent cloisonnés. Les auteurs plaident pour des politiques coordonnées combinant trois piliers : répression pénale ciblée, développement socio-économique pour réduire l’attractivité du recrutement criminel et terroriste, et engagement communautaire pour renforcer le soutien populaire aux actions gouvernementales.
Le document souligne également les limites des approches purement répressives. Comme l’ont montré les exemples colombiens ou afghans, les politiques d’éradication brutale (épandage aérien de cultures de coca, frappes militaires massives) peuvent aliéner les populations locales et paradoxalement renforcer la légitimité des groupes terroristes qui se présentent alors comme des protecteurs ou des fournisseurs de services alternatifs.
Voir l’étude ici
ou https://media.licdn.com/dms/document/media/v2/D4E1FAQE90I6ek4wJZw/feedshare-document-pdf-analyzed/B4EZnUxZPFHgAc-/0/1760211347264?e=1761177600&v=beta&t=D2yEKxTeJkcMjyWQVcheVod06_pw-pE9M2v3Qd00H_4
| Désolé, cette page est seulement accessible aux abonnés de crimorg.com! |
|---|